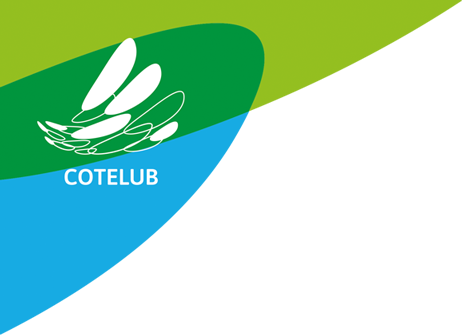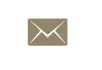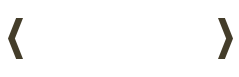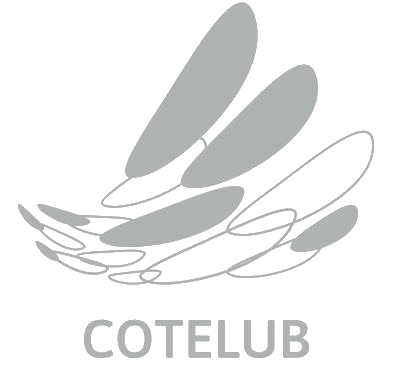ClimAgri® est un outil et une démarche de diagnostic énergie-gaz à effet de serre pour l’agriculture et la forêt, à l’échelle des territoires, diffusé par l’ADEME.
A l’échelle des territoires et notamment en zone rurale, le secteur agricole peut représenter jusqu’à 40 à 50 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Sur Cotelub, le secteur agricole représente 16% des émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre du développement des plans climats à l’échelle régionale (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires [SRADDET]) ou infrarégionale (Plans climat air énergie territoriaux [PCAET)] une analyse fine des impacts de l’agriculture au regard de sa production s’avère souvent nécessaire, d’autant que cette échelle d’analyse est pertinente pour élaborer un plan d’action tenant compte des spécificités de l’agriculture locale.
Les objectifs de cette démarche sont, à l'échelle du territoire, d'agir sur :
- la réduction des consommations d’énergie de l’agriculture ;
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques ;
- l’augmentation de la production de matière première agricole (potentiel nourricier).
A partir du diagnostic de la situation initiale, les utilisateurs peuvent construire et tester des scénarios pour évaluer et hiérarchiser les actions à mettre en œuvre sur les :
Enjeux énergétiques et gaz à effet de serre
Stockage du carbone dans les sols
Enjeux alimentaires du Luberon
Enjeux liés à l’eau et à l’irrigation dans le Luberon